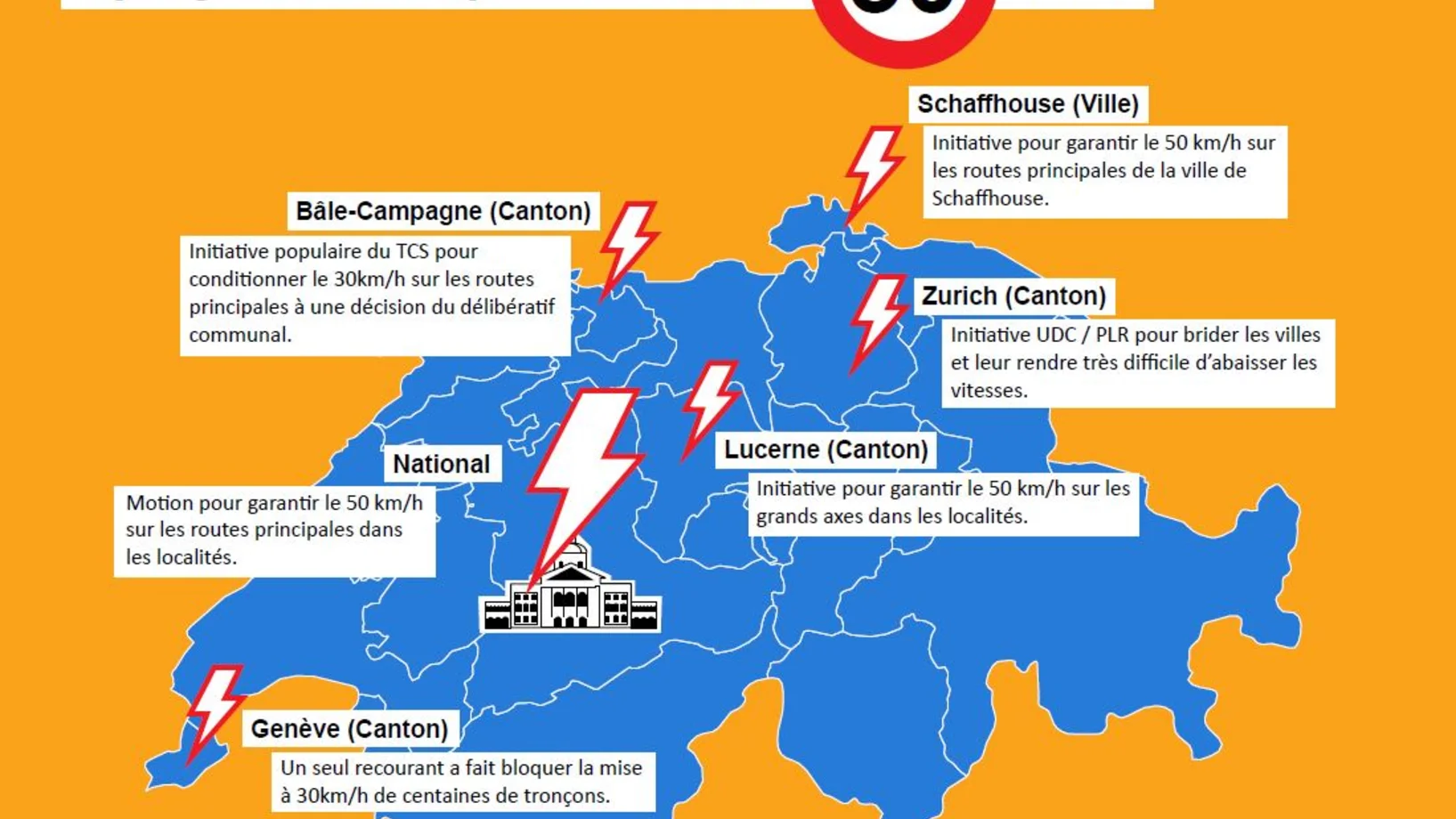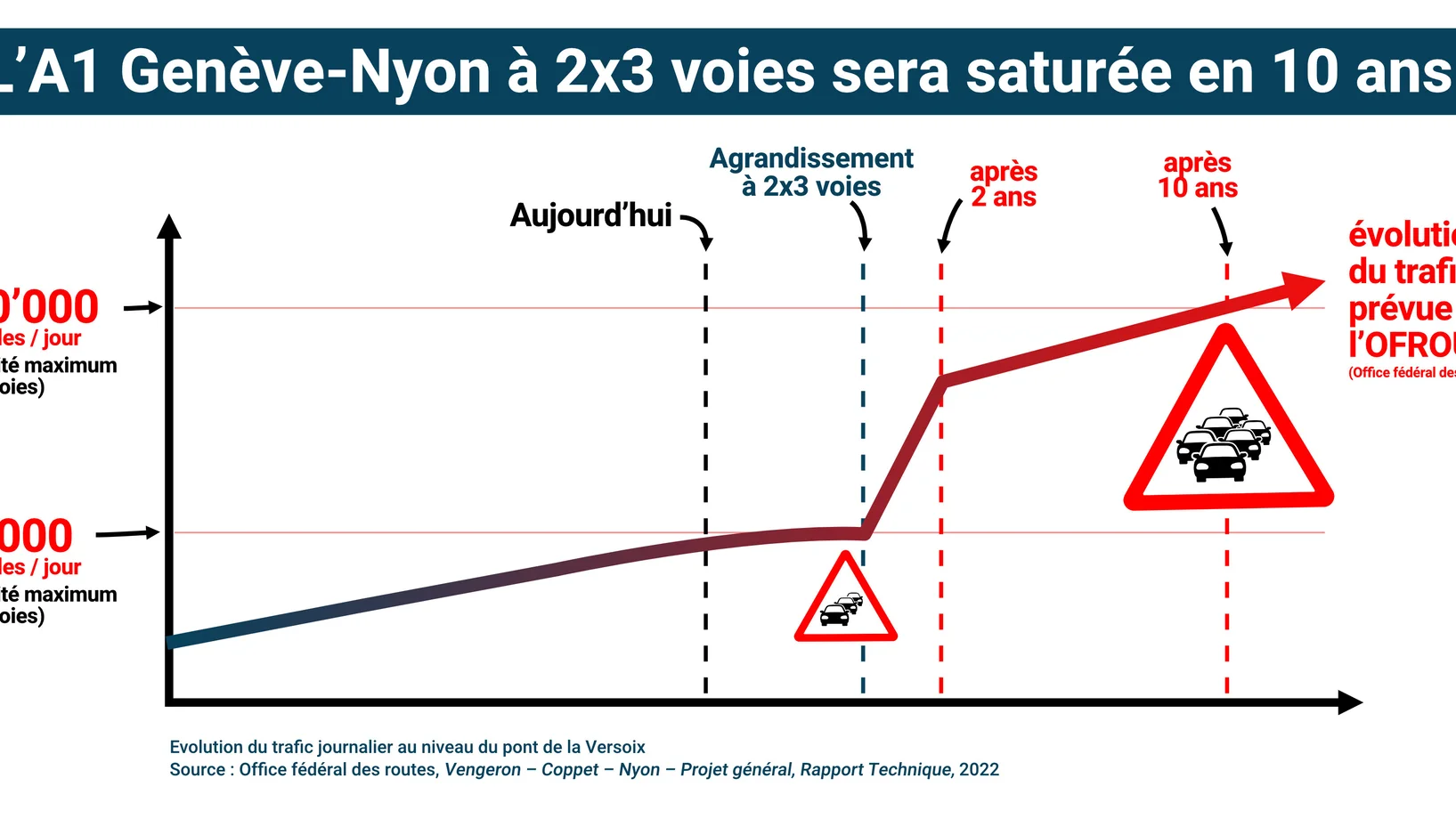Renchérir les coûts de la voiture par des taxes est une idée très ancienne… mais qui peine souvent à s’imposer face aux fortes oppositions. Comment sortir de l’impasse ?
En Suisse, le trafic motorisé engendre 20 milliards de coûts externes – santé, environnement, etc. – épongés par l’entier de la société. Or, statistiquement, les plus riches sont ceux qui sont davantage motorisés et qui roulent le plus. C’est une redistribution à l’envers : les plus modestes paient pour les dommages causés par les mieux lotis. Absurde et injuste. Faire payer les automobilistes en renchérissant le coût de la voiture apparaît donc comme une mesure écologique et sociale. Et les pistes concrètes ne manquent pas : péages urbains, « mobility pricing », hausses des prix des carburants, des parkings… Mais ces taxes linéaires soulèvent de fortes oppositions.
Inégalités socio-géographiques réelles
On trouve tout d’abord des oppositions légitimes, portant la voix des personnes économiquement défavorisées dont la situation professionnelle et/ou géographique les contraint à une dépendance automobile : horaires nocturnes ou peu flexibles, connexion domicile-travail de périphérie à périphérie ardue en transport public, télétravail impossible, etc. Même si en Suisse, il est admis que cela ne concerne qu’une proportion réduite de la population, nous ne devons pas sous-estimer cette réalité. Mais, à l’inverse, il ne faut pas non plus l’exagérer.
Instrumentalisation par la droite populiste
Or, le lobby automobile et ses relais amplifient artificiellement souvent ces cas spécifiques de précarité sociale et géographique pour dénoncer les taxes sur l’automobile comme « antisociales ». Derrière cette préoccupation de façade pour les populations précaires se cache souvent la défense d’un statu quo qui profite majoritairement à des automobilistes « de confort » plutôt aisés ainsi qu’à l’industrie automobile. Mais si l’opposition entre « bobos écolos urbains » et « vraies gens modestes vivant hors des villes » est une caricature démagogique de la droite populiste, nous devons prendre garde à ne donner aucune prise à ce narratif.
Rendre le projet désirable
Tout projet de taxe devrait prévoir des mécanismes tenant compte des inégalités socio-géographiques : exemptions selon les besoins réels et le revenu, création d’un fonds social pour aider les plus précaires à faire la transition, taxation multicritères des véhicules (poids, taille, puissance, CO2 …) pour pénaliser les véhicules de luxe, transports publics abordables ou gratuits, etc.
Pour contrer le populisme anti-écologiste de l’extrême-droite, la réduction des inégalités et la réduction du trafic doivent absolument aller de pair. C’est seulement ainsi que le tournant dans les transports deviendra désirable pour la partie de la population qui en bénéficiera le plus. Car ceux qui ne partent pas (ou peu) en vacances ou qui n’ont pas de résidence secondaire sont aussi ceux qui profitent le plus d’un espace public apaisé. La rue est le jardin de ceux qui n’en ont pas !

Les taxes automobiles n’ont de chances d’être acceptées que si elles sont conçues de manière socialement juste.